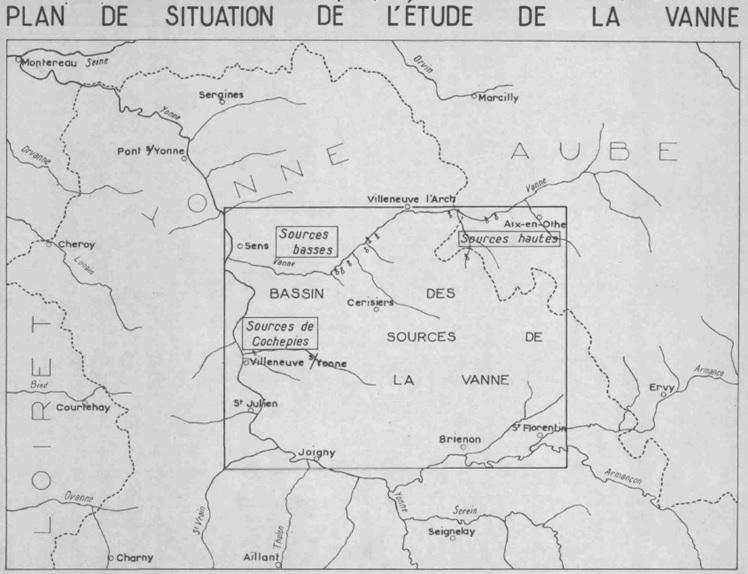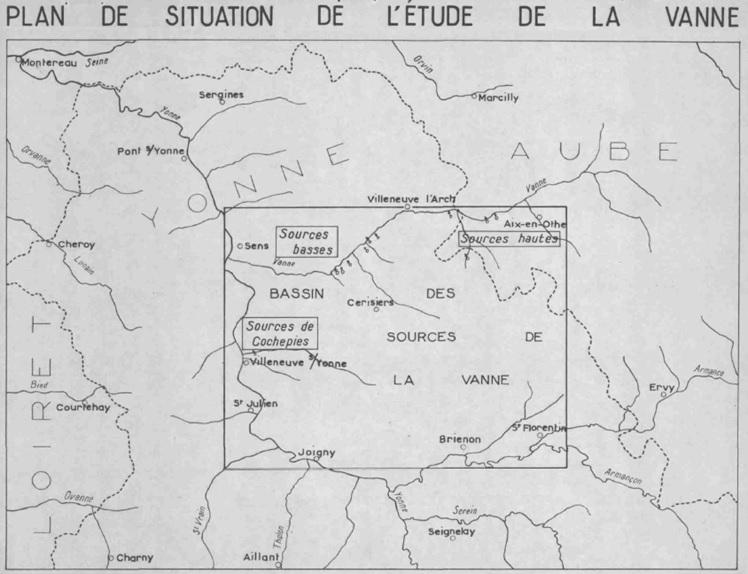Aquifères
Le Plateau d’Othe est constitué d’un ensemble de niveaux crayeux recouvert par quelques dépôts datant du Tertiaires (argileux, sableux à graveleux). Les premiers niveaux de craie correspondent aux couches du Sénonien inférieur et du Turonien moyen. Il s’agit d’une craie blanche bien perméable. L’eau s’y infiltre bien jusqu’à ce qu’elle rencontre la craie compacte et marneuse du Turonien inférieur et du Cenomanien qui bloque les écoulements. Un autre
aquifère
, sableux celui-ci, se trouve en dessous de ces niveaux Cénomanien : il s’agit de l’
Aquifère
des Sables de l’Albien. Toutefois, les nombreuses sources qui émergent de ce plateau (les Sources de la Vanne étant les plus importantes) se trouvent à une altitude supérieure à l’altitude de l’Albien. Les eaux de la Vanne sont donc uniquement issues des écoulements au sein de la Craie du Sénonien inférieur et du Turonien moyen dont l’épaisseur peut atteindre 350m.
Deux types d’écoulements hydrogéologiques
Écoulement karstique
Le Pays d’Othe est globalement impacté par une tectonique qui tend à faire pendre les terrains du secteur vers le NNW. On peut toutefois noter une légère ondulée d’axe N-S. Les cours d’eau au droit du plateau sont inexistants témoignant d’une bonne infiltration des eaux de surface dans le sous-sol. Ce caractère infiltrant est d’ailleurs étayé par la présence de rivières souterraines et de nombreuses cavités karstiques favorisant l’écoulement en souterrain des eaux. De plus, de nombreux traçages ont montré des vitesses de transit de plusieurs centaines de mètres par heure. Ces transferts rapides se sont fait à travers un réseau de fractures et de diaclases au sein de la roche. En effet, le plateau est fracturé selon plusieurs directions. Les deux directions qui jouent le plus grand rôle dans l’écoulement sont obliques et orientées NE-SW et E-W. Ces diaclases ont pour la plupart la même direction que les vallées et leur densité est plus importante au niveau des vallées qu’au niveau des plateaux. Il y a donc un écoulement karstique important orienté dans le sens des vallées. La plupart des sources sont d’ailleurs associées à la présence de diaclases.
Ce fonctionnement contraste avec celui observable en rive droite de la Vanne, où les écoulements sont beaucoup plus lents et où la composante karstique y est quasi absente.
Écoulement de
nappe
Grâce à des mesures de débits et des mesures de pluviométries, il a pu être constaté un retard d’un à deux mois entre les maxima de pluviométrie et les maxima des débits des sources. Ces observations témoignent d’un écoulement lent dans le milieu souterrain (d’autant plus que les points d’infiltration les plus éloignés des sources se situent à moins de 15 km). Il y a donc une contradiction entre les données de traçages (qui témoignent d’un écoulement karstique rapide) et les données de débits (qui montrent un écoulement lent). L’étude de R. Hlavek et al. (
BRGM
-1959) montre ainsi qu’il existe une réserve interstitielle au sein même de la craie.
La levée d’une carte
piézométrique
permet de mettre en évidence une direction d’écoulement comprise entre l’Ouest et le Nord. Tout comme les écoulements karstiques, les écoulements au sein de la
nappe
de la Craie jouent un rôle important dans l’alimentation des sources.
L’étude des chroniques longue de débit des sources de la Vanne (
BRGM
-2014) met en évidence que les sources situées en pied de la vallée de la Vanne montrent, sur le long terme, une baisse de débit depuis environ 50 ans, et que cette baisse n’est ni corrélable avec le changement climatique, ni avec les prélèvements (
AEP
, industrie, irrigation) sur les bassins d’alimentation des sources. Ce sont très vraisemblablement les modifications de l’aménagement du territoire (notamment agricole) qui en abaissant le niveau de la
nappe
à l’aval immédiat de ces sources a entrainé une baisse de niveau dans les captages.
Interaction entre les différents écoulements
Il est donc admit que dans le cadre du
bassin
de la Vanne, il coexiste deux types de circulation dans la craie. Les précipitations atmosphériques s’infiltrent dans la craie et forment une
nappe
qui s’écoule lentement vers les sources avec une direction d’écoulement comprise entre l’Ouest et le Nord. Il existe par ailleurs, des conduits karstiques, souvent axés sur des vallées, qui sont des zones de circulations préférentielles.
Les relations du
karst
et de la
nappe
sont les suivants :
- En période de crue, la
nappe
est plus haute que le
karst
et ce dernier joue le rôle de drain dans la
nappe
(qu’il rabat légèrement).
- En période normale, le niveau de la
nappe
correspond à peu près au niveau des réseaux karstiques. Le
karst
est alors une zone préférentielle d’alimentation et de drainage de la
nappe
.
- En période d’étiage, la
nappe
descend en dessous des conduits karstiques. Le débit des sources a baissé mais il reste assez constant car il y a uniquement une circulation de
nappe
. Le
karst
fonctionne seulement pour conduire à la
nappe
quelques brusques précipitations atmosphériques.
On peut donc expliquer les contradictions enregistrées entre la vitesse de circulation déduites des colorations d’une part et des réactions des sources aux pluviométries d’autre part. En effet, si la grande masse d’eau stockée dans les pores et dans les fines diaclases de la craie circule très lentement, dès qu’une petite quantité de cette eau arrive dans un conduit karstique, elle circule à grande vitesse vers les exutoires.
 Seine-Normandie
Seine-Normandie